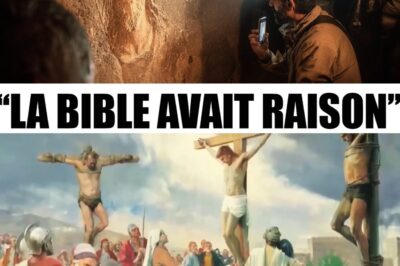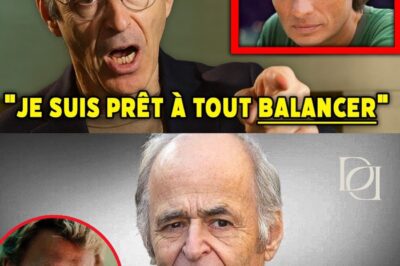Retraites Impayées, Dette Hospitalière : Le Rapport Choc Qui Révèle le Coût Réel des Accords Franco-Algériens de 1968

Retraites Impayées, Dette Hospitalière : Le Rapport Choc Qui Révèle le Coût Réel des Accords Franco-Algériens de 1968
La question des Accords franco-algériens de 1968, qui régissent la circulation, le séjour et l’emploi des ressortissants algériens en France, est une pomme de discorde historique, traditionnellement abordée sous l’angle régalien de la sécurité et du contrôle migratoire. Cependant, un travail parlementaire d’une ampleur inédite, mené par le député Charles Rodoin, vient de changer radicalement la nature du débat. Son rapport, focalisé sur les implications financières, économiques et sociales du texte, révèle un coût exorbitant et injustifié pour les finances publiques françaises, en particulier sur les volets des retraites et de la dette hospitalière. Le constat est sans appel : un accord jugé « anachronique » non seulement crée une « rupture d’égalité » entre les étrangers, mais contraint la France à assumer indûment les obligations financières d’un État tiers.
Raison d’État contre Vérité Budgétaire : Un Bras de Fer Politique
Dès les premières minutes de son intervention, Charles Rodoin pose le cadre d’un affrontement idéologique. Face aux déclarations du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, qui semble vouloir « enterrer l’idée de remettre en cause » l’accord de 1968, le député rappelle que son travail ne s’inscrit pas dans la seule dimension sécuritaire. Le rapport qu’il a produit est le fruit d’une analyse détaillée des conséquences économiques, sanitaires et sociales de cet accord.
La position défendue par le député et sa majorité est claire et simple : il est temps d’en finir avec ce régime d’exception. Un citoyen uniquement algérien devrait rentrer dans le droit commun, c’est-à-dire être traité comme tout autre étranger extra-européen. De même, un citoyen franco-algérien devrait être considéré comme un Français à part entière. La remise en cause de l’accord est, selon lui, la seule manière d’atteindre cette normalisation.
Cette position se heurte inévitablement à la « raison d’État », qui privilégie la stabilité diplomatique avec Alger. Pour Rodoin, cependant, le coût de cette stabilité est devenu insoutenable, et il est du devoir des parlementaires d’éclairer le débat public sur des vérités dérangeantes.
Le Détournement Historique : Une Rupture du Principe d’Égalité
L’une des analyses les plus percutantes du rapport concerne la manière dont l’accord de 1968 a été « détourné de son intention initiale ». Initialement, ce texte avait été conçu pour limiter drastiquement l’immigration, la concentrant sur les travailleurs algériens dont la France avait besoin. Les articles de l’époque prévoyaient une limitation sévère de l’immigration familiale et pour soins.
Or, c’est la décision politique qui a ensuite bouleversé cet équilibre. Charles Rodoin pointe du doigt l’année 1976 et la décision du Secrétaire d’État Paul Dijoud, sous Valéry Giscard d’Estaing, qui a créé le regroupement familial dans la loi et, par des mesures réglementaires, l’a facilité spécifiquement entre la France et l’Algérie. Cette décision politique a ensuite été entérinée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.
Le résultat de ce détournement est une rupture du principe d’égalité entre les étrangers. Les Algériens bénéficient d’avantages comparatifs, comme la facilitation du regroupement familial, mais sont paradoxalement désavantagés sur d’autres points, comme l’accès au « passeport talent », un visa pour les professionnels hautement qualifiés. L’accord, en créant un régime sui generis, maintient la France dans une situation paradoxale dont il est urgent de sortir.
L’Hémorragie Sociale : La France Payer pour Alger
Le cœur du scandale financier réside dans le transfert de charge sociale que l’Algérie fait peser sur la France, en particulier dans le domaine des retraites. Pour isoler le coût réel, le rapport a méthodiquement écarté les sujets non directement liés à l’accord, comme le logement social ou les OQTF (Obligations de Quitter le Territoire Français). Il s’est concentré sur les dépenses sociales directement liées, dont les retraites, le RSA ou l’aide sociale aux personnes âgées.
Le cas des retraites est le plus « frappant ». Charles Rodoin illustre la situation par un exemple simple : un Algérien ayant travaillé 20 ans en France et 20 ans en Algérie. En vertu de la convention de sécurité sociale de 1980, qui découle des accords de 1968, la France est tenue de verser la moitié de sa pension, au prorata des années de cotisation, ce que le député juge légitime.
Le nœud du problème : L’accord prévoit que la Caisse Nationale de Retraite algérienne verse l’autre moitié de la pension. Or, « dans des milliers de cas, l’Algérie ne le fait pas ».
Face à ce manquement de l’État algérien, c’est la France qui est contrainte de compenser pour éviter que les retraités ne tombent dans la précarité la plus totale. Elle le fait en versant l’ASPA (Aide Sociale aux Personnes Âgées). La conséquence est sidérante : en compensant systématiquement, la France décharge l’État algérien de ses propres responsabilités et supprime toute incitation pour ces citoyens à se retourner vers Alger. La France se mue, malgré elle, en caisse de secours universelle.
Une Dette Hospitalière Qui Creuse le Déficit

L’autre volet financier majeur est la dette hospitalière, un exemple flagrant où « la France applique des dispositions que l’Algérie n’applique pas ». En vertu des conventions de sécurité sociale bilatérales, il existe une dette dans les deux sens pour la prise en charge de soins.
Le rapport a chiffré cette dette pour la période 2018-2024 :
Dette de la France envers l’Algérie : 430 millions d’euros.
Dette de l’Algérie envers la France : 102,5 millions d’euros.
Ce déséquilibre flagrant s’explique par le fait que davantage de citoyens algériens (y compris les binationaux ayant cotisé) se font soigner en France que l’inverse. Mais au-delà de ces chiffres sur la dette publique, le député souligne un problème plus profond : l’aveuglement systémique de l’État sur la mobilisation des données. L’absence de données consolidées sur la dette privée (ce que les citoyens algériens pourraient devoir directement aux hôpitaux ou cliniques privés français) signifie que le coût réel total de ces accords demeure, à ce jour, inconnu.
Plaidoyer pour la Normalisation : La Fin du Régime d’Exception
Pour Charles Rodoin, l’objectif est clair : il est « temps de dénoncer ces accords » et les conventions qui y sont liées pour revenir à un régime de droit commun, similaire à celui qui existe avec des pays comme la Guinée, le Japon ou le Canada.
Le député, rapporteur sur le budget de l’immigration, annonce qu’il déposera des amendements pour concrétiser ses conclusions lors des débats budgétaires à l’Assemblée. Il salue d’ailleurs une première étape, le réhaussement du prix du timbre de visa, qui fait contribuer davantage les étrangers aux finances publiques. Son intention est de continuer le bras de fer pour que l’Exécutif prenne des décisions courageuses, même si le ministre de l’Intérieur actuel ne semble pas partager sa vision.
Ce rapport, qualifié de « colossal inédit », a eu le mérite d’arracher la question franco-algérienne à la seule rhétorique sécuritaire pour la placer devant l’impératif de la gestion saine des finances publiques. L’enjeu n’est plus seulement politique, il est budgétaire. Et il est désormais aux mains du gouvernement d’accepter cette nouvelle vérité : maintenir le statu quo des accords de 1968 revient à accepter une subvention financière permanente à l’étranger, payée par le contribuable français.
News
La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de silence
La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de…
La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de silence
La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de…
Le Jardin Secret de Jean : Comment une Découverte Archéologique Sous le Tombeau de Jésus Valide l’Évangile au Mot Près.
Le Jardin Secret de Jean : Comment une Découverte Archéologique Sous le Tombeau de Jésus Valide l’Évangile au Mot Près….
Le Mythe Brisée : À 73 ans, Jean-Jacques Goldman Révèle la « Tension Latente » et le « Mépris » qui ont Défini sa Collaboration avec Johnny Hallyday.
Le Mythe Brisée : À 73 ans, Jean-Jacques Goldman Révèle la « Tension Latente » et le « Mépris »…
7 Minutes de Vérité : Le Réquisitoire de Lecornu sur AUKUS qui a humilié Londres et secoué l’OTAN.
7 Minutes de Vérité : Le Réquisitoire de Lecornu sur AUKUS qui a humilié Londres et secoué l’OTAN. Article: 7…
Le Sacifice Émotionnel de Brigitte Bardot : Pourquoi l’Icône de la Sensualité a Rejeté 60 Millions d’Euros pour un Héritage Qui Touche Toute la France
Le Sacifice Émotionnel de Brigitte Bardot : Pourquoi l’Icône de la Sensualité a Rejeté 60 Millions d’Euros pour un Héritage…
End of content
No more pages to load