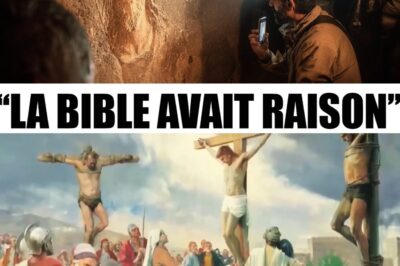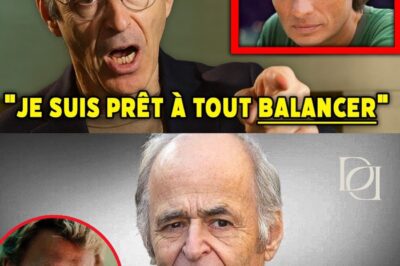L’Affaire Cohen-Legrand : Le Terrible “Deux Poids Deux Mesures” Qui Révèle la Faillite Idéologique du Service Public

L’Affaire Cohen-Legrand : Le Terrible “Deux Poids Deux Mesures” Qui Révèle la Faillite Idéologique du Service Public
Dans un paysage médiatique déjà fragilisé par une crise de confiance profonde, l’affaire dite « Cohen-Legrand » ne marque pas un simple dérapage, mais révèle une crise institutionnelle et éthique sans précédent au sein du service public audiovisuel français. Ce n’est pas tant le contenu des conversations privées qui fait scandale, mais le traitement différencié, le « deux poids deux mesures » appliqué par les directions et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). L’onde de choc expose une fracture béante, laissant l’opinion publique face à une question essentielle : le service public est-il encore au service de tous les Français, ou est-il devenu un instrument de militantisme idéologique financé par l’impôt ?
Le Silence Assourdissant des Institutions
Au cœur de la polémique, l’absence de réaction officielle face à l’évidence des faits alimente la suspicion. L’affaire, qui concerne les journalistes Patrick Cohen et Thomas Le Grand et la révélation de propos tenus lors d’une conversation privée dans un lieu public, a rapidement dépassé la simple querelle de confrères. Alors que les médias publics se terrent dans un silence radio, la Société des journalistes de France Inter a rapidement apporté son soutien, signalant une connivence institutionnelle que les Français peinent à comprendre.
Le mutisme le plus frappant est celui de la direction de Radio France, et notamment de sa présidente, Delphine Ernotte. Son silence est interprété par les critiques, dont Mathieu Valet, député et porte-parole du Rassemblement National, et le chroniqueur Raphaël Stinville, comme un assentiment tacite, une reconnaissance assumée d’un choix idéologique. « Sa réaction, elle est déjà contenue dans son silence. En fait, elle assume très clairement de maintenir à l’antenne Patrick Cohen », analyse Raphaël Stinville. Cette posture institutionnelle ne fait qu’aggraver la dégradation de l’image et de la crédibilité de la parole du service public, déjà mises à rude épreuve.
L’Argument du « Piège » et la Relativisation Sélective
Face à la fuite de leur conversation, Patrick Cohen a choisi de répliquer en portant plainte pour violation de conversation privée. Cet argument, repris par de nombreux soutiens, tente d’affaiblir la portée des révélations. Cependant, cette ligne de défense est immédiatement confrontée aux précédents historiques.
On se souvient notamment des révélations des conversations privées de Liliane Bettencourt en 2010. À l’époque, la révélation de ces bandes sonores par Mediapart et Le Point avait été saluée par une partie de la profession et par la justice, qui avait relaxé les journalistes en reconnaissant l’utilité publique des enregistrements. Le tribunal de Bordeaux avait alors établi que l’intérêt général primait sur la confidentialité. La défense de Patrick Cohen est ainsi perçue comme un exemple de relativisation sélective, où les mêmes outils d’investigation sont jugés légitimes ou illégitimes selon qu’ils visent l’« incorrect » ou qu’ils exposent le militantisme de l’« entre-soi » médiatique.
Le Tribunal de l’Éthique : La Loi du « Deux Poids Deux Mesures »
Le nœud du problème réside dans l’application d’une éthique professionnelle à géométrie variable. Les critiques dénoncent une disparité de traitement qui ne peut être expliquée que par une adhésion, ou une tolérance, à une certaine ligne politique.
L’exemple de Jean-François Achilli est le plus foudroyant. Ce journaliste de France TV Info, dont le salaire est financé par l’impôt des Français, a été « suspendu tout de suite et dans la foulée licencié » sur le simple « soupçon » d’avoir collaboré à la réflexion ou à l’écriture d’un livre pour Jordan Bardella. Le geste est rapide, brutal et sans appel, Achilli étant catalogué dans le camp du « diable absolu » par les dirigeants du service public.
À l’inverse, Patrick Cohen, dont le positionnement politique est non seulement connu, mais dont la parole est jugée « abîmée » par sa proximité avec des figures comme Raphaël Glucksmann ou le Parti socialiste, est maintenu à l’antenne. Les faits sont établis, son rôle est majeur au sein de la grille de France Inter et de France Télévisions. Cette différence de traitement est perçue comme une « injustice » flagrante et une violation du principe d’équité que nos institutions devraient garantir.
Les Antécédents Ignorés : Une Police de la Pensée Assumée
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Patrick Cohen est au centre d’une controverse sur son rôle éditorial et son militantisme. Raphaël Stinville rappelle qu’en 2013, dans un débat avec Frédéric Taddeï, le journaliste avait assumé de ne pas recevoir à son antenne certaines personnalités qui « pensaient mal ». Cette démarche, qualifiée de « police de la pensée », est désormais transposée à une échelle supérieure, utilisant le service public et sa dotation annuelle de 4 milliards d’euros pour « combattre politiquement ses adversaires ».
Le malaise est accentué par d’autres précédents d’éviction pour conflit d’intérêts. Des journalistes comme Marie Drucker ou Thomas Sotto avaient été écartés de la présentation du journal de 20 heures car leurs conjoints étaient des femmes et des hommes politiques. Or, l’affaire Cohen met en lumière un paradoxe : on sanctionne la proximité matrimoniale, mais on tolère le militantisme politique personnel assumé, pourvu qu’il s’aligne sur l’idéologie dominante au sein des rédactions.
Pour les critiques, le choix est clair : Thomas Le Grand, qui a eu l’« honnêteté » et le « courage » de reconnaître des propos maladroits, a été « sacrifié » par sa direction, qui avait besoin d’un geste de façade. Ce sacrifice visait en réalité à protéger Patrick Cohen, jugé indispensable à la grille de France Inter, et dont le départ aurait « chamboulé » toute la programmation. Le maintien de Cohen est donc une décision éditoriale qui prime sur l’équité et l’éthique journalistique.
L’ARCOM et la « Justice » à Double Vitesse

La responsabilité de l’ARCOM, l’institution garante de la régulation et de l’équité du temps de parole, est également mise en cause avec virulence. Sur des chaînes d’information en continu comme CNews ou Europe 1, l’ARCOM est réputée pour sa rigueur et sa célérité, tapant « dur comme fer » sur les moindres signalements, allant jusqu’à décompter le temps de parole à la seconde.
Pourtant, face à l’évidence du militantisme de Patrick Cohen, l’organisme brille par son inaction. La question se pose alors : l’ARCOM va-t-elle considérer Patrick Cohen comme un « militant PS » et décompter son temps de parole, comme la logique et l’équité l’exigeraient ? Pour Mathieu Valet, le contraste est saisissant : « Pour ces chaînes-là, c’est open bar en fait. Donc moi, j’aime pas le deux poids deux mesures. » Ancien policier, il rappelle l’importance fondamentale de la « justice et l’équité » dans une démocratie et dénonce le fait que « des gens sont plus égaux que d’autres » au sein du paysage audiovisuel français.
Le Coût Financier et la Responsabilité Politique
Derrière l’enjeu éthique se cache un enjeu financier et politique de premier ordre. Les Français, par leur impôt, financent le service public à hauteur de milliards d’euros. Pour les voix critiques, il est inadmissible que cet argent serve à « idéologiser les médias par les gauchistes ». Dans un contexte de dette publique record, cette utilisation des fonds publics pour des combats partisans est perçue comme un luxe que la nation ne peut plus se permettre.
Le débat est donc relancé sur la mission même du service public : doit-il être un espace de neutralité et de pluralisme, ou un haut-parleur pour une certaine élite politique et médiatique ? Les élus du Rassemblement National, en la personne de Mathieu Valet, ont déjà annoncé qu’ils ne lâcheraient pas l’affaire, écrivant à la chaîne parlementaire et à France Télévisions pour demander des comptes sur le maintien de Patrick Cohen.
Le silence des institutions n’est pas un apaisement ; il est au contraire une déclaration, soulignant un choix idéologique et une profonde crise de légitimité. L’affaire Cohen-Legrand restera dans les mémoires comme le moment où le service public a mis en scène sa propre faillite, brisant un peu plus le pacte de confiance qui devrait l’unir à l’ensemble des Français.
News
La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de silence
La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de…
La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de silence
La vérité scellée de Neverland : ce que contenait le garage secret de Michael Jackson, ouvert après 15 ans de…
Le Jardin Secret de Jean : Comment une Découverte Archéologique Sous le Tombeau de Jésus Valide l’Évangile au Mot Près.
Le Jardin Secret de Jean : Comment une Découverte Archéologique Sous le Tombeau de Jésus Valide l’Évangile au Mot Près….
Le Mythe Brisée : À 73 ans, Jean-Jacques Goldman Révèle la « Tension Latente » et le « Mépris » qui ont Défini sa Collaboration avec Johnny Hallyday.
Le Mythe Brisée : À 73 ans, Jean-Jacques Goldman Révèle la « Tension Latente » et le « Mépris »…
7 Minutes de Vérité : Le Réquisitoire de Lecornu sur AUKUS qui a humilié Londres et secoué l’OTAN.
7 Minutes de Vérité : Le Réquisitoire de Lecornu sur AUKUS qui a humilié Londres et secoué l’OTAN. Article: 7…
Le Sacifice Émotionnel de Brigitte Bardot : Pourquoi l’Icône de la Sensualité a Rejeté 60 Millions d’Euros pour un Héritage Qui Touche Toute la France
Le Sacifice Émotionnel de Brigitte Bardot : Pourquoi l’Icône de la Sensualité a Rejeté 60 Millions d’Euros pour un Héritage…
End of content
No more pages to load