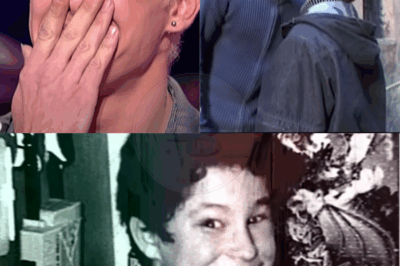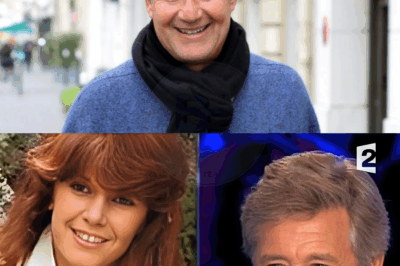Boualem Sansal : une libération qui secoue Paris, Berlin et Alger
C’est une nouvelle qui a traversé l’Europe comme une onde de choc.
Le 12 novembre 2025, après plus d’un an d’incarcération en Algérie, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié et libéré grâce à une intervention diplomatique de l’Allemagne. À 81 ans, affaibli par la maladie, il a immédiatement quitté le pays pour rejoindre Berlin, où il doit être pris en charge médicalement.
Une issue heureuse pour un homme, mais une gifle symbolique pour la diplomatie française, restée impuissante là où Berlin a su convaincre.
L’histoire de Boualem Sansal commence bien avant sa détention. Auteur de romans puissants sur la mémoire, la dictature et la liberté, il s’est souvent montré critique envers le régime algérien. En octobre 2024, il est arrêté à l’aéroport d’Alger alors qu’il s’apprête à se rendre en France pour un colloque littéraire. On lui reproche des propos jugés « hostiles à l’État », notamment lorsqu’il évoquait la question sensible des frontières avec le Maroc.
Quelques mois plus tard, il est condamné à cinq ans de prison pour « atteinte à l’unité nationale ». Un verdict dénoncé par de nombreux intellectuels comme une « vengeance politique ».

Pendant des mois, les appels à sa libération se multiplient. Des écrivains, journalistes, et même plusieurs députés français réclament son transfert humanitaire. Mais du côté d’Alger, c’est le silence. Le pouvoir algérien refuse toute ingérence, et la France, malgré ses demandes répétées, échoue à obtenir le moindre geste.
C’est alors que l’Allemagne entre en scène.
Selon plusieurs sources diplomatiques, le président allemand Frank-Walter Steinmeier aurait personnellement adressé une lettre à son homologue algérien, plaidant la cause de Sansal pour des raisons « strictement humanitaires ». Berlin s’appuie sur deux arguments : l’âge avancé de l’écrivain et son état de santé préoccupant.
Contre toute attente, Alger accepte.
Le communiqué tombe : Boualem Sansal est gracié et pourra quitter le territoire algérien.
Pour beaucoup d’observateurs, cette issue est le fruit d’une médiation discrète mais efficace de l’Allemagne, alors que la France, ancienne puissance coloniale, peine à renouer un dialogue constructif avec Alger.
Cette libération n’est pas qu’un acte humanitaire ; elle est hautement politique.
Comme le souligne le géopolitologue Brahim Oumansour sur TF1 Info : « On assiste à un glissement de l’Algérie vers l’Allemagne. » En clair, Alger cherche à diversifier ses alliances et à réduire sa dépendance historique vis-à-vis de Paris.
Berlin, de son côté, profite de cette ouverture pour renforcer ses relations avec un acteur clé du Maghreb, stratégique sur les plans énergétique et sécuritaire. Dans un contexte de guerre en Ukraine et de crise du gaz, l’Algérie apparaît pour l’Allemagne comme un partenaire alternatif et prometteur.
Pendant ce temps, à Paris, la stupeur domine.
Le député français Robert Ménard, proche du Rassemblement national, a réagi sans détour :
« Merci à l’Allemagne pour ce qu’elle a fait, mais quelle humiliation pour la France ! »
Une phrase qui résume parfaitement le malaise ressenti à l’Élysée.
Car c’est bien un échec de la diplomatie française : malgré son poids historique et culturel en Algérie, Paris s’est retrouvée spectatrice d’un succès diplomatique allemand.
Mais au-delà des symboles politiques, le cas Sansal interroge notre rapport à la liberté d’expression.
Son arrestation pour des propos littéraires illustre la fragilité du débat intellectuel dans une partie du monde arabe où la critique reste perçue comme une menace.
Sa libération, elle, rappelle que les valeurs humanistes peuvent encore triompher, même au prix de jeux d’influence entre États.
Lorsqu’il a atterri à Berlin, Boualem Sansal, visiblement épuisé, a simplement déclaré :

« Je veux juste respirer. »
Un mot simple, mais d’une puissance symbolique immense.
Pour les autorités algériennes, cette grâce constitue aussi une manœuvre habile. Elle permet d’apaiser les critiques internationales sans donner l’impression de céder à la pression française. En passant par l’Allemagne, Alger ménage sa fierté nationale tout en envoyant un message subtil : l’ère de la dépendance vis-à-vis de Paris est terminée.
C’est une démonstration de souveraineté autant qu’un geste humanitaire.
L’épisode illustre une tendance plus large : la recomposition silencieuse des alliances méditerranéennes, où Berlin gagne du terrain là où Paris recule.
Pour la France, cette affaire est un avertissement. Elle révèle les limites d’une diplomatie encore trop liée à la mémoire coloniale, et parfois incapable de parler d’égal à égal avec ses anciens partenaires. La libération de Sansal montre aussi qu’en 2025, le soft power culturel ne suffit plus : seule une diplomatie pragmatique et multilatérale peut encore peser.
Aujourd’hui, Boualem Sansal est libre, mais son combat continue. Son prochain livre, annoncé par son éditeur allemand, s’intitulera Le Silence d’Alger. Il y racontera, dit-on, les jours d’emprisonnement, la peur, mais aussi la dignité retrouvée. Un texte qui promet d’être à la fois une confession personnelle et une arme politique.
Son retour à la littérature pourrait bien devenir un acte de résistance supplémentaire, une manière de rappeler que les mots restent plus forts que les murs des prisons.
Ainsi, derrière la libération d’un homme, se cache une leçon de géopolitique et d’humanité.
Car Boualem Sansal, en sortant de sa cellule, n’a pas seulement retrouvé la liberté : il a aussi exposé au grand jour le déplacement du centre de gravité diplomatique entre la France, l’Algérie et l’Allemagne.
Et dans le silence de sa première nuit libre, à Berlin, résonne une évidence :
la littérature, quand elle dérange, reste un acte de courage – et parfois, une arme plus puissante que la diplomatie.
News
💍 Après 11 Ans de Vie Commune : Laurent Delahousse et Alice Taglioni Sont Enfin Mariés 😍✨
💍 Après 11 Ans de Vie Commune : Laurent Delahousse et Alice Taglioni Sont Enfin Mariés 😍✨ Bonjour à…
Il y a 3 minutes : Adriana Karembeu et Marc Lavoine annoncent enfin leur mariage heureux
Il y a 3 minutes : Adriana Karembeu et Marc Lavoine annoncent enfin leur mariage heureux Bonjour à toutes et…
Le Destin Brisé : Cédric et Fabrice (Y a que la vérité qui compte), le cauchemar post-émission et les retrouvailles déchirantes pour une seconde chance
Le Destin Brisé : Cédric et Fabrice (Y a que la vérité qui compte), le cauchemar post-émission et les retrouvailles…
« Adieu mon amour » la triste annonce de Pierre Perret
Pierre Perret, un cœur meurtri par la perte de sa fille : le combat d’un père face à l’indicible Pierre…
« Il est mort » la triste annonce de Patrick Sabatier
Patrick Sabatier : à 74 ans, une nouvelle vie devant la caméra Il y a des visages qui font partie…
« J-5 ! » : Lucile (L’amour est dans le pré) partage avec enthousiasme ce moment inattendu de son nouveau voyage
La famille est sur le point de s’agrandir. D’ici quelques jours, Lucile va donner naissance à son troisième enfant. Avant…
End of content
No more pages to load