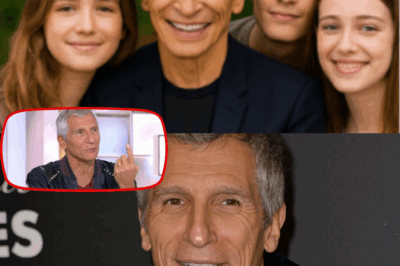Tragedie silencieuse – Ludivine Sagnier bouleversée sur scène : en récitant “Le Consentement”, elle éclate en sanglots hors caméra – Quels secrets personnels se cachent derrière ce choix artistique si intime ? Était-ce un rôle… ou une confession ? Son entourage garde le silence, même son mari esquive la question – Pourquoi maintenant, après des années de silence ? La vérité serait-elle trop lourde à dire ? L’actrice tente d’apaiser sa colère, mais à quel prix ? Les spectateurs, eux, en sortent troublés – Découvrez ce que personne n’ose vraiment dire… détails bouleversants ci-dessous.
«À 14 ans, on n’est pas censée être attendue par un homme de 50 ans à la sortie de son collège, on n’est pas supposée vivre à l’hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l’heure du goûter.» Cette phrase du «Consentement», de Vanessa Springora, contient en condensé tout le propos du livre: la dénonciation de la pédocriminalité de l’écrivain Gabriel Matzneff et l’emprise qu’il a exercée sur de très jeunes filles.

«Le consentement» a entraîné un changement de loi en France et a été vendu à plus de 300’000 exemplaires. Désormais, le cinéma s’en empare (en salle dès le 6 décembre en Suisse romande), ainsi que le théâtre, par le biais d’un très beau seule en scène interprété par Ludivine Sagnier, présenté le 9 décembre à l’Octogone, à Pully.
Presque commentaires des événements, les percussions d’un batteur amènent une dimension d’urgence et de danger, notamment lorsque la jeune Vanessa tombe dans la gueule du loup.
En fond de scène, un voile opaque symbolise la psyché de Vanessa Springora, derrière lequel se jouent les douleurs tant physiques que psychiques – jusqu’à un épisode psychotique. Pour rentrer à l’inverse dans la conscience du public, c’est en bord de scène que s’installe Ludivine Sagnier – qui jongle entre les différents âges et émotions du personnage, aidée dans son interprétation par son air d’éternelle adolescente. Interview.
Qu’est-ce qui vous a décidée à incarner ce texte, a priori difficile à transposer autrement qu’en monologue?
Dès le départ, pour Sébastien (ndlr: Davis, le metteur en scène), la forme du monologue s’est imposée car il permet la transmission de la parole (assez douloureuse) de Vanessa Springora – malgré l’intervention ici et là d’autres personnages (comme la mère, le père, Matzneff…). Ces passages dialogués apportent des bulles d’oxygène par opposition aux moments où j’incarne Vanessa, qui demandent beaucoup de sincérité et de sobriété.
«Je voulais garder un point de vue le plus intact possible pour comprendre l’innocence de cette jeune fille qui trouve cet homme charmant.»
Comment avez-vous préparé ce rôle? Avez-vous lu des livres de Matzneff?
Après avoir échangé par écrit, j’ai rencontré Vanessa la veille des répétitions. Et j’ai ouvert quelques ouvrages de Matzneff, dont un livre axé sur la pédophilie, qui m’est tombé des mains. Voir de loin suffit à réaliser à quel point c’est ignoble. Je n’avais pas du tout envie de me salir et de m’imposer cet écœurement, parce que j’aurais été plus en colère que la résilience de Vanessa au moment où elle écrit. Je voulais garder un point de vue le plus intact possible pour comprendre l’innocence de cette jeune fille qui trouve cet homme charmant. J’ai aussi discuté du rôle de Matzneff avec Jean-Paul Rouve, parce qu’on l’interprète finalement chacun à notre façon (ndlr: lui, dans le film).
Qu’apporte la pièce de plus que le livre?
Notre objectif est de valoriser cette parole, de la partager avec le public. Mieux que d’autres formes d’expression, le théâtre permet une réflexion commune où tout le monde, tout d’un coup, est obligé de s’interroger conjointement. «Où est notre responsabilité? Qu’aurions-nous fait, en tant que parents?» Je m’avance au-devant de la scène et me tais (ce qui est parfois pris pour un trou): lors de ces silences, ces questions communes remuent les spectateurs. Avec le livre, on est dans la réflexion. Quant au cinéma, sa vocation est de rallier le plus grand nombre.
Vous donnez bénévolement des cours de théâtre aux jeunes de banlieue. Avec cette pièce, faites-vous aussi œuvre de prévention?
Bien entendu! Je suis mère de trois filles, donc forcément sensibilisée au sujet. Aujourd’hui, nous connaissons tous quelqu’un qui, enfant, a subi des abus sexuels ou les avons nous-mêmes subis. Avec cette pièce, j’apporte ma pierre à l’édifice du travail de guérison et de prévention, pour permettre aux jeunes de développer des outils de reconnaissance face aux prédateurs. Transmettre cette parole allège un peu ma colère.
Vous avez commencé très jeune au cinéma. Avez-vous été confrontée à de tels prédateurs?
J’ai rencontré des hommes grossiers et des gros cons, à différencier des prédateurs sexuels, desquels j’ai été épargnée. J’ai grandi dans un environnement suffisamment solide. Dans mon entourage proche, tout le monde n’a pas cette chance. J’ai envie de participer à cette résistance.
«Je souhaite que chaque objet – pièce de théâtre et film – ait sa fonction et se réponde.»

Le livre et la pièce décortiquent le schéma d’emprise. Le film moins, mais il «apporte quelque chose que les mots n’ont pas pu atteindre», selon Springora, avec des images donnant la nausée. Ces objets culturels sont-ils complémentaires?
Il y a certainement complémentarité, même si je ne peux pas me prononcer car je me suis interdit de voir le film. J’ai eu peur d’en être trop imprégnée, alors que je souhaite justement que chaque objet ait sa fonction et se réponde. Je le verrai quand j’aurai terminé la tournée. Je suis heureuse qu’il connaisse un succès assez foudroyant chez les jeunes.
Le film est plus frontal sur certaines horreurs. Le livre dit cela assez pudiquement, la pièce encore plus…
C’est la délicatesse de l’adaptation de Sébastien Davis, dont l’objectif est de transmettre cette parole mais aussi de mettre en valeur les qualités littéraires de l’écriture de Vanessa Springora. Nous ne nous attardons pas sur le fait divers dégueulasse et ignoble: a primé l’intérêt pour le combat de cette femme pour se reconstruire, pour transcender sa douleur en objet artistique. La sexualité est donc assez conceptualisée dans cette mise en scène. À l’inverse, au cinéma, puisqu’on est obligé de raconter une histoire de manière plus réaliste, on est obligé de s’attaquer à cette vision terrible et concrète.
News
“JE N’AI PAS PU LUI DIRE AU REVOIR” 😭 Nagui se confie comme jamais sur la perte dévastatrice de ses parents, tous deux emportés par le cancer. Une douleur intime qui est devenue le moteur de son engagement. 💥 Son histoire est un message de courage pour tous ceux qui luttent. Un témoignage à lire absolument, en commentaire. ⬇️
“JE N’AI PAS PU LUI DIRE AU REVOIR” 😭 Nagui se confie comme jamais sur la perte dévastatrice de ses…
LA POLÉMIQUE ENFLE ! 😠 Le nouveau jeu produit par Nagui, “100% France”, est sous le feu des critiques. Népotisme, copinage… Les internautes sont furieux de voir “toujours les mêmes” à l’écran, y compris sa propre femme ! 🤫 Découvrez pourquoi le casting de l’émission a déclenché un tel scandale. L’article complet est en commentaire ! 👇
LA POLÉMIQUE ENFLE ! 😠 Le nouveau jeu produit par Nagui, “100% France”, est sous le feu des critiques. Népotisme,…
NAGUI COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU ! 🤫 Derrière l’animateur star se cache un père aux principes de fer. Éducation stricte, rapport à l’argent intransigeant… il se confie comme jamais. 👨👧👦 Découvrez la philosophie surprenante de Nagui pour ses 4 enfants, loin des clichés du show-business. L’article complet est en commentaire ! 👇
NAGUI COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU ! 🤫 Derrière l’animateur star se cache un père aux principes de fer….
IL A DÉCLARÉ SA FLAMME ! 😳 On le connaît pour sa répartie, mais face à son idole de jeunesse, France Gall, Nagui a perdu tous ses moyens ! Il lui a avoué son amour… 💥 Un moment de gêne et d’émotion qu’il n’a jamais oublié. Plongez dans les coulisses de cette rencontre culte qui révèle une facette inconnue de l’animateur. L’article est en commentaire ! ⬇️
IL A DÉCLARÉ SA FLAMME ! 😳 On le connaît pour sa répartie, mais face à son idole de jeunesse,…
LA VÉRITÉ ÉCLATE ENFIN ! 🤯 Après plus de 20 ans d’amour, Nagui lève enfin le voile sur le VRAI secret de sa relation avec Mélanie Page. Ce n’est pas ce que vous croyez ! 🤫 Derrière les sourires, il y avait une vérité qu’il a mis du temps à admettre. Découvrez la confession inattendue de l’animateur sur l’amour de sa vie en commentaire ! 👇
LA VÉRITÉ ÉCLATE ENFIN ! 🤯 Après plus de 20 ans d’amour, Nagui lève enfin le voile sur le VRAI secret de…
LE SECRET LE MIEUX GARDÉ DE NAGUI ! 🤫 Pour les 20 ans de sa fille aînée Roxane, l’animateur et sa femme Mélanie Page ont brisé leur règle d’or en postant un message public bouleversant. ❤️ Un geste rarissime qui en dit long… Découvrez le portrait touchant de cette jeune femme de l’ombre et la signification de cet hommage. L’article complet est en commentaire ! 👇
LE SECRET LE MIEUX GARDÉ DE NAGUI ! 🤫 Pour les 20 ans de sa fille aînée Roxane, l’animateur et…
End of content
No more pages to load